Une expérience d'enseignement de l'informatique
il y a un demi-siècle
au lycée de La Celle-Saint-Cloud
Jacques Baudé
Cet article repose sur mes souvenirs d'une expérience vécue pendant la décennie 1970, ainsi que sur une étude de MM. Pitié et Scherer réalisée d'octobre 1971 à juin 1972 pour le compte du ministère de l'Éducation nationale, à la demande de M. Mercouroff, chargé de mission à l'informatique [1]. Cette étude prolongeant celle effectuée l'année précédente par MM. Queniart et Yolin, disponible sur le site de l'EPI [2].
Un heureux voisinage
La Compagnie internationale pour l'informatique (CII) était relativement proche de La Celle-Saint-Cloud, nombre de parents d'élèves y travaillaient. À la suite d'une visite organisée début 1969 pour des élèves de 1re C et quelques professeurs, des parents présents au conseil d'établissement du lycée proposèrent le prêt d'un ordinateur 10 010 [3] (cf. figure 1(a)) accompagné de quatre télétypes ASR33 (cf. figure 1(b)) plus un télétype-maître avec lecteur de ruban perforé.
|
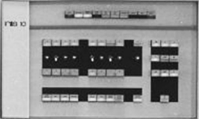
(a) IRIS10.
|
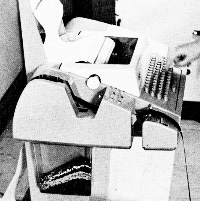
(b) ASR33.
|
Figure 1.
Ce fut cette situation favorable qui permit l'expérience pionnière d'enseignement de l'informatique pilotée par l'Institut national de recherche et de documentation pédagogique (INRDP) et l'Office français des techniques modernes de l'éducation. (OFRATEME). Remarquons que si on a coutume de dire que l'introduction de l'informatique dans l'enseignement français trouve son origine dans le séminaire de Sèvres, la décision de la CII de prêter un ordinateur au lycée-collège de La Celle Saint Cloud date de 1969 et le séminaire de Sèvres de mars 1970 [4].
L'équipe enseignante
Après une année scolaire 1969–1970 de « tâtonnement expérimental » (l'ordinateur ne fut livré au lycée-collège qu'en janvier 1970), l'enseignement ne débuta vraiment qu'à la rentrée scolaire 1970. L'équipe pluridisciplinaire se composait de sept enseignants volontaires disposant d'heures de décharge de service ; dans le cadre de l'introduction de l'informatique dans l'enseignement secondaire. Deux collègues avaient suivi un stage intensif chez le constructeur et une spécialiste de la CII, ancienne enseignante, assistait les professeurs pour les travaux pratiques. Je n'ai rejoint l'équipe qu'à la rentrée 1971 avec comme tout viatique la curiosité d'un naturaliste pour ce « cerveau artificiel » qui avait débarqué au lycée, la lecture autodidacte de « La science informatique » de Jacques Arsac (Dunod, 1970) qui traitait déjà des quatre piliers de l'informatique : l'information, les algorithmes, les langages et les machines.
Le programme
Le programme, mis au point par l'équipe enseignante en liaison avec les collègues de l'INRDP, portait classiquement sur l'information, sa représentation, son traitement, l'organisation d'un ordinateur (portes logiques...) et l'histoire de l'informatique. En travaux pratiques, il s'agissait de résoudre des problèmes simples : d'abord choix de ces problèmes, conception des algorithmes et programmation. De 1970 à 1973, l'IRIS 10 ne disposant que d'un Fortran simplifié, les problèmes étaient de nature mathématique (somme des n premiers nombres, moyenne, tris de nombres, solutions d'équations...). À partir de janvier 1973, l'arrivée du Mitra 15 [6] doté du LSE [3] avec chaînes de caractères alphanumériques a permis de diversifier (pluriel des noms en ou, occurrence de mots dans un texte, correction orthographique, cadavres exquis !). À partir de 1973, le lycée de La Celle Saint Cloud fut un des 58 lycées équipés [1].
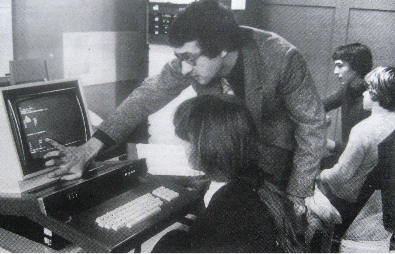
Figure 2. : Salle informatique au lycée-collège de La Celle-Saint-Cloud en l973 avec Christian Lafond (SIE-INRDP) au premier plan et le le Mitra 15 à l'arrière plan.
Les élèves – de seconde puis progressivement de première et terminale – qui suivaient cet enseignement étaient tous volontaires ; en effet cet enseignement facultatif venant s'ajouter à l'emploi du temps, les séances avaient lieu généralement aux heures de repas ou en fin d'après midi. Il s'agissait d'une heure de cours par semaine et de deux heures de travaux pratiques par quinzaine : trois élèves par télétype ASR33 les premières années, deux par console de visualisation à partir de l'arrivée du Mitra l5 en 1973 (cf. figure 2). Sans modèle de référence, nous avons su mettre en place et faire évoluer un enseignement de l'informatique original en liaison avec les différentes disciplines. Cette expérience, qui s'étendit sur la décennie 1970, fut riche d'enseignement. D'abord, elle nous a convaincus de la complémentarité entre l'enseignement de l'informatique et l'utilisation de l'outil informatique dans les disciplines. On parlait alors d'enseignement assisté par ordinateur (EAO). Ouvrir le capot d'un logiciel pédagogique (écrit à l'époque en LSE) avec des élèves ayant quelques notions de programmation était de nature à nous convaincre du bien fondé de notre démarche. Sur le plan pratique, l'expérience de La Celle Saint Cloud fit apparaître des conditions dont certaines sont à replacer dans le contexte de l'époque :
nécessité d'une salle informatique sécurisée recevant l'unique ordinateur de l'établissement ; nécessité d'un responsable compétent à la fois sur le plan technique mais surtout sur le plan pédagogique pour faire le lien avec les collègues des différentes disciplines ; effectif maximum des groupes de TP de telle sorte qu'il n'y ait que deux élèves par console ; indispensable formation des enseignants et nécessité de décharges de service ; richesse pédagogique d'une équipe pluridisciplinaire ; souci de démocratie par une concertation permanente.
L'ouverture vers les autres disciplines
Dans la mesure où l'équipe enseignante était pluridisciplinaire (maths, anglais, histoire-géographie, musique, sciences naturelles...) et que nous avions l'essentiel de nos services dans nos disciplines d'origine, les liens entre l'enseignement de l'informatique et les disciplines traditionnelles se faisaient naturellement. Les membres de l'équipe commençaient à utiliser les rares logiciels pédagogiques disponibles, certains participant aux groupes de recherche disciplinaires de l'INRDP chargés de concevoir et de développer des logiciels utilisables dans les différentes disciplines. Tout était à inventer. C'est ainsi que je participais au groupe biologie et informatique dès 1972.
Formations lourdes et légères
À la suite du séminaire de Sèvres de mars 1970 [4], la réponse française fut notamment la création de formations approfondies, dites « lourdes ». Plusieurs des membres du groupe furent amenés à suivre cette formation. En ce qui me concerne, ce fut au cours de l'année 1973-1974 à l'ENS de Saint Cloud sous la direction d'André Poly, un remarquable pédagogue !
L'originalité de l'expérience française tient en effet dans l'attitude des responsables, le chargé de mission à l'informatique, Wladimir Mercouroff, et le comité pédagogique qu'il anime au ministère de l'Éducation nationale : les problèmes posés par l'introduction de l'informatique au lycée sont pédagogiques, leur solution est affaire d'enseignants. L'expérience débuta donc par une sérieuse formation informatique d'enseignants plongés dans la réalité industrielle des constructeurs d'ordinateurs. La première année (1970-1971) chez trois constructeurs, 40 enseignants chez IBM, 20 à la CII et 20 chez Honeywell-Bull. Les leçons de ces premiers stages tirées, la formation approfondie se déroulera les années suivantes (de 1971 à 1976) dans des centres universitaires des académies de Grenoble, Nancy, Toulouse, Paris, Rennes. Au total, 528 enseignants de différentes catégories et disciplines furent formés. Avec des variations selon les centres de stage, on trouvait sensiblement les mêmes éléments : notions générales d'informatique (information, algorithmes, programmation, structure de l'ordinateur...). L'initiation à la programmation avait tendance à dominer compte tenu de la rareté, voire de l'absence, de logiciels pédagogiques. Rappelons qu'à l'époque, il n'existait pratiquement pas en France de logiciels utilisables dans les disciplines générales, en dehors de ceux qui seraient progressivement conçus et réalisés par les stagiaires. Une formation « légère » fut également mise en place par le Centre national de télé-enseignement (CNTE) de Vanves sous forme d'un cours par correspondance rédigé par un groupe d'enseignants, cours complété par quatre jours de stage sur machine. Elle concerna environ 5000 enseignants. Enfin, nombreux furent les autodidactes autour des machines. La formation des enseignants précéda les machines. Cela mérite d'être souligné.
Les groupes disciplinaires coordonnés par l'INRDP
Pendant que se déroulait l'expérience de La Celle Saint Cloud, la Section informatique et enseignement (SIE), créée dès 1971 à l'INRDP, regroupait un certain nombre d'enseignants formés dans des groupes de recherche disciplinaires. Plusieurs membres de l'équipe enseignante pluridisciplinaire se sont investis dans ces groupes. Ces enseignants recevaient des décharges de service pour leur donner le temps nécessaire à leur recherche et à la conception et à la réalisation de logiciels. Les logiciels et le LSE (ainsi que les sources) étaient diffusés gratuitement dans le système éducatif. Environ 800 logiciels ont été produits, toutes disciplines confondues, de 1972 à 1979. Plus de la moitié n'a été utilisée que localement, mais environ 400 ont été répertoriés et diffusés dans les 58 lycées (et au-delà par la suite) soit sous forme de rubans perforés soit sous forme de disques souples plus tard. Chaque logiciel était accompagné d'une fiche pédagogique comprenant le livret du maître, le livret de l'élève, le descriptif du programme et le listing en LSE [4].
On pourra se référer à l'étude de l'INRP qui traite de la banque de logiciels, de l'analyse des logiciels et de leur utilisation [7]. Contrairement à l'idée qu'on peut se faire ou qu'on a pu se faire, surtout à l'époque de l'EAO, les approches pédagogiques étaient variées et souvent très novatrices. Certes, il y avait les logiciels d'enseignement « tutoriel » et les exercices d'entraînement et de contrôle des connaissances, mais il y avait aussi les logiciels de simulation, de traitement de données et les jeux pédagogiques. Après adaptation aux micro-ordinateurs, puis au nano-réseau, une partie de ces logiciels se retrouvera dans les opérations « 10 000 micros » et « 100 000 micros », puis dans les « valises » du plan IPT (informatique pour tous [2]) et même au-delà.
Le club informatique
Après l'installation du Mitra 15 en 1973, il fut décidé, à La Celle-Saint-Cloud, la création d'un club informatique plus largement ouvert. La démarche fut d'ailleurs assez générale dans les lycées équipés. De retour dans leurs établissements, les enseignants formés étaient très souvent à l'origine de ces clubs où s'organisait un enseignement selon des modalités variées où dominait la programmation. Ces clubs concernaient aussi bien les collégiens que les lycéens. Ainsi, au concours de programmes ouvert aux jeunes d'âge scolaire [5], organisé en 1981 par l'AFCET avec la participation active de l'EPI, sur les 113 dossiers retenus, 65 avaient comme point d'appui l'un des 58 lycées-collèges (16 dossiers provenaient de collégiens). La plupart de ces travaux n'auraient pas été menés à bien sans l'ambiance intellectuelle des clubs.
L'évaluation
Nous n'avons jamais eu connaissance de l'évaluation officielle de cette expérience originale qui s'est déroulée au cours de la décennie 1970 à La Celle-Saint-Cloud. Sinon, que mon expérience acquise dans cet enseignement optionnel expérimental, et ma fonction de secrétaire général de l'EPI proche du terrain, ont fait que j'ai été sollicité pour participer au Comité scientifique national (CSN) chargé du suivi de l'option informatique des lycées, créé en 1982 par Claude Pair, directeur des lycées, et présidé par André Danzin, ex-directeur de l'IRIA et président de l'AFCET [5] . En revanche, l'expérience des 58 lycées, qui a donné la priorité à l'utilisation de l'informatique dans les disciplines, a fait l'objet d'une évaluation sérieuse commandée à l'INRP par le directeur des lycées [7].
Jacques Baudé
Président d'honneur de l'EPI,
Membre d'honneur de la SIF.
Paru dans 1024 le Bulletin de la SIF n° 23 d'avril 2024, pages 73-78.
https://1024.societe-informatique-de-france.fr/2024/04/1024_23_2024_73.html
Cet article est sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International.
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr
Références
[1] Jacques Baudé. L'expérience des « 58 lycées ». 1024, 4 :105-115, octobre 2014. doi :10.48556/ SIF. 1024 .4 105..
[2] Jacques Baudé. Le plan « informatique pour tous ». 024, 5 :95-108, mars 2015. doi :10.48556/SIF. 1024.5.95.
[3] Jacques Baudé. Le système lse. 1024, 7 :41-56, juillet 2015. doi :10.48556/SIF.1024.7.41.
[4] Jacques Baudé. Le séminaire de sèvres (mars 1970). 1024, 11 :115-127, septembre 017.doi :10.48556/SIF. 1024,11.115.
[5] Jacques Baudé. Concours de programmes afcet — 1981. 1024, 18 :117-128, 11 2021.doi :10.48556/SIF. 1024,18.117.
[6] Daniel Caous et Jacques Baudé. Les mini-ordinateurs « Éducation nationale » de la décennie 1970. 1024, 19 :41-48, avril 2022.doi :10.48556/SIF. 1024,19.41.
[7] INRP. Dix ans d'informatique dans l'enseignement secondaire (1970-1980). Imprimerie Hemmerlé, Petit et Cie, 1981. URL :
https://www.epi.asso.fr/blocnote/Dix_ans_INRP_ 1981.pdf.
.NOTES
[1] https://www.epi.asso.fr/blocnote/etude_pitie-scherer.pdf
[2] https://www.epi.asso.fr/blocnote/etude_queniart-yolin.pdf
[3] http://www.feb-patrimoine.com/projet/10010/cii_10010.htm
[4] Voir par exemple le logiciel Mendel,
http://www.epi.asso.fr/revue/histo/h78-mendel-jb23.htm
[5] https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_française_pour_la_cybernétique_économique_ et_technique
|